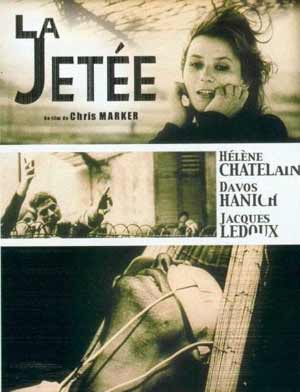A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.
Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers, Billy Costigan.
Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en "sous-marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui.
Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.
Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser sa peau...
Oulà je sens que je ne vais pas me faire des amis avec ce film...
Attention, la critique contient des SPOILERS
Comme tout le monde le sait, « Les Infiltrés » est le remake de « Infernal Affairs », le polar chinois qui a défrayé la chronique.
C'est quoi un remake?
Des Américains, à court de bonnes idées et passionnés par le sujet qui se disent : « et si on faisait notre version à nous? ». C'est ça un remake.
En général un remake c'est comme une suite : c'est moins bien que l'original.
Il y a les rares exceptions et puis il y ceux qui savent se démarquer en imposant leur propre style tout en conservant les qualités du premier, comme James Cameron (« True Lies »), Terry Gilliam (« L'armée des 12 singes ») ou encore Tim Burton (« Sweeney Todd »).
Quand on voit les innombrables films d'horreur « à la japonaise » qui ont fleuri sur le marché américain depuis « Ring », on comprend que faire un remake n'est pas à la portée du premier venu.
Essayons de regrouper les qualités de « Infernal Affairs » pour tenter de comprendre pourquoi le film est si réussi.
D'abord les deux acteurs principaux (Andy Lau et Tony Leung) sont excellents, mais les seconds rôles (surtout Anthony Wong et Eric Tsang) le sont aussi.
Le casting est donc une réussite pure et simple.
Passons à la mise en scène.
Non seulement le scénario est remarquable mais il est de plus constamment mis en valeur par des images léchées, une bande son recherchée et un suspense omniprésent. Sans oublier que les réalisateurs évitent de nous prendre pour des idiots en s'abstenant d'expliciter sans arrêt, ce qui rend le film à la fois fluide et captivant.
Et c'est comme ça que nait un film culte...
Du côté des Américains, ca cogite sec pour essayer de mettre en forme le projet.
Le moment est venu d'élire le réalisateur qui s'appropriera le film.
Et quelle ne fut pas la surprise d'apprendre que c'est le roi des « Gangs of New York », Martin Scorsese lui même, qui va s'atteler à la tâche!
L'homme qui a lancé la carrière de DeNiro, d'Harvey Keitel, de Ray Liotta et de Joe Pesci, l'homme qui a redonné au polar mafieux ses lettres de noblesse, l'homme qui a immortalisé Daniel Day Lewis dans le rôle de Bill le Boucher...
Avec un tel poids lourd derrière la caméra, on sentait pondre un nouveau chef d'oeuvre!
Le casting d' »Infernal Affairs » rassemble parmi les plus grands acteurs hong kongais?
Aucun problème, on va leur montrer ce que c'est un casting à l'américaine!
Et voici donc réunis à l'écran « les deux mâles les plus sexy de la planète » (c'est pas moi qui le dit...), Leonardo DiCaprio et Matt Damon et quelques uns des plus grands vétérans du cinéma, j'ai nommé : Martin Sheen, Alec Baldwin et Jack Nicholson!
Argh! Ce genre de casting on le rêve, on ne s'attend pas à ce qu'il devienne réalité.
J'en connais qui aurait fait une crise cardiaque en découvrant la liste des acteurs.
Sans surprise, « Les Infiltrés » rafle plusieurs oscars et fait un carton au box-office.
Le film est adulé par la presse comme par le public.
On dit qu'il surpasse de loin son aîné et on s'agenouille devant Scorsese avant de le couvrir de fleurs.
Le film entre dans la légende!
Ou pas...
En tant que film, il n'est déjà pas terrible mais en tant que remake, il touche le fond.
Comme précédemment, essayons de regrouper les défauts de « Les Infiltrés » pour tenter de comprendre pourquoi le film est si raté.
D'abord les acteurs principaux.
Pour être acteur, aujourd'hui il suffit d'avoir une belle gueule, savoir jouer est devenu accessoire. Pourtant DiCaprio et Damon sont beaux ET savent jouer.
On ne peut nier que sous la houlette de Spielberg, DiCaprio fait des merveilles et Damon a eu plusieurs rôles assez réussis (« Le talentueux Mr Ripley », « Dogma », la trilogie de « La vengeance dans la peau »...) mais ici, on a quoi?
Deux mannequins de mode qui posent et qui gesticulent pour tenter de donner du charme à leurs personnages.
Si le personnage d'Andy Lau était à la fois impassible et serein, celui de Damon devient très rapidement crispant. Sourire mielleux, il aligne les blagues les moins drôles possibles pour conquérir une fille qui lui tombe de toute façon dans les bras en claquant des doigts.
Il est déjà loin le temps où Jason Bourne et son regard pénétrant suffisaient à nous tenir en haleine...
Quant au personnage de DiCaprio il n'a pas le millième d'une miette d'une once de la plus infime particule du charisme de celui qu'incarnait Tony Leung!
Alors que Tony Leung en disait long en un regard, lui en fait parfois des tonnes sans le moindre résultat.
Emotionnellement, il est aussi crédible en bad boy infiltré que moi en chanteuse d'opéra...
De même dans leurs rôles respectifs Martin Sheen et Jack Nicholson n'arrivent jamais à la hauteur d'Anthony Wong et de Eric Tsang.
Si Nicholson, largement moins cabotin que d'habitude, s'en sort malgré tout avec les honneurs, le personnage de Sheen est insignifiant.
Wong s'accaparait l'écran.
A chaque scène il trouvait le petit plus qui faisait qu'on adorait son personnage! Sheen, lui, joue les pater familias de remplacement, la figure autoritaire mais juste mais à aucun moment on ne se s'attache à lui.
Si bien que quand le personnage de Wong meurt on en a presque les larmes aux yeux (la brillante mise en scène y étant pour quelque chose) mais quand c'est celui de Sheen, c'est presque indifférent qu'on le regarde expérimenter les bonnes vieilles lois de la gravité...
En revanche, Alec Baldwin est vraiment bon dans le film. Plein d'humour et de dérision, son personnage se détache aisément du lot.
Mais la grosse surprise c'est que parmi toutes ces stars, c'est l'acteur qu'on attendait le moins qui se révèle être le meilleur...
Pour la course aux statuettes, ils sont tous coiffés au poteau par Mark Whalberg.
Quoi? Mark-charisme zéro-Walhberg? Le type qui à lui seul a massacré « Max Payne » et la « Planète des Singes »? Nominé en tant que meilleur second rôle?
Et oui, comme quoi tout arrive...
Physiquement, son personnage est un émule de celui de Guy Pearce dans « LA Confidential », le caractère exécrable et le language fleuri en plus.
Sa performance est tellement réussie qu'on regrette même qu'il ne soit pas plus souvent à l'écran. Un comble...
Voilà pour le casting. Passons à la mise en scène.
On connait le goût de Scorsese pour la violence crue et réaliste et les dialogues de rue aux « fucking » en guise de virgules et de « motherfucker » en guise de point.
Il ne fallait pas avoir inventé l'eau tiède pour comprendre qu'on pouvait dire adieu à la réalisation à la fois lyrique et poétique de « Infernal Affairs ».
Voilà donc Scorsese qui filme en lumière naturelle, sans grands effets de montage, et qui multiplie les scènes de dialogues ponctués comme il les aime.
On peut préférer cette approche plus ancrée dans le réel à celle de l'original mais faute est de reconnaître qu'on ne retrouve jamais les qualités scénaristiques de « Infernal Affairs ».
Si les chinois privilégient les sous entendus et font en sorte que chaque réplique soit importante au récit, Scorsese accumule les dialogues ringards et inutiles et nous mâche le scénario bien comme il faut pour qu'il soit sûr qu'on est tout compris.
Le coup de la lettre griffonée par exemple : dans « Infernal Affairs », la lettre disparait assez vite, si bien qu'on est presque surpris quand on la retrouve dans le bureau d'Andy Lau.
Cette fois on a bien 15 gros plans de la-dite lettre pour qu'on puisse la reconnaître à tout moment et qu'on se dise : « Hum. Cette lettre a sûrement de l'importance pour la suite du récit... ».
Peut être que le public américain a besoin d'être guidé à ce point mais honnêtement c'est vraiment nous prendre pour des idiots!
De même pour les dialogues.
Si dans le premier une ligne, voire un regard, suffisait parfois à en dire énormément, ici c'est la surenchère qui prime.
Et ça crie, et ça s'insulte et ça s'empoigne virilement...
Les acteurs s'agitent dans tous les sens et la tension recherchée du premier film aboutit ici à une cacophonie sans nom.
Mais le pire c'est que si les 1h30 d'« Infernal Affairs » sont un modèle de narration, Scorsese s'octroie une heure(!) supplémentaire pour venir à bout de son récit.
Il en profite pour développer ses personnages afin de leur donner plus de profondeur?
Si c'est le cas, c'est raté.
Il prend le temps de paufiner les scènes d'action?
Honnêtement elles n'ont rien d'extraordinaire et elles sont si rares qu'on les voit à peine passer.
Alors à quoi sert cette heure supplémentaire?
Ma foi, je cherche encore...
La bande son de « Infernal Affairs » est une réussite à elle seule et d'habitude Scorsese nous gratifie d'anciens tubes Tarantinesques, cette fois rien.
Excepté un superbe morceau de métal irlandais, pas une bonne chanson à se mettre sous la dent...Dommage.
La seule vraie différence, c'est la fin.
Ceux qui n'ont pas vu « Infernal Affairs » vont en rester sur les fesses (pour être poli) mais contrairement au premier, un épilogue clot l'histoire pour de bon.
Le public américain n'aurait sûrement pas supporté de voir le « méchant » s'en tirer : tout le monde est mort mais au moins la morale est sauve, ouf.
Pathétique...
« Les Inflitrés » est bien « le choc cinématographique de l'année ».
Le choc de voir un grand réalisateur comme Scorsese plomber ce qui aurait pu être un classique, malgré des moyens considérables et un casting en or massif.
Le film est sauvé de justesse par des seconds rôles formidables mais, comme leur nom l'indique, les seconds rôles on les voit moins souvent que les premiers.
Scorsese se démarque de l'original en imposant son propre style mais il ne retient aucune qualité de son modèle.
Il s'éternise dans des dialogues aussi laborieux qu'inutiles et met en scène des personnages unidimensionnels qui font presque honte en regard des originaux.
Et en plus ça dure 2h30...
Longue vie à Tony Leung!
Note : *