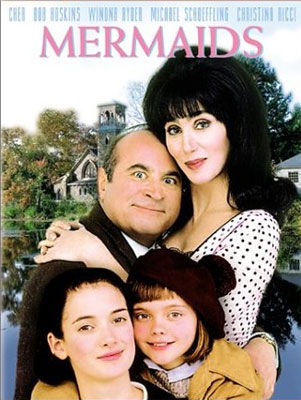En 208 après J.-C., l'empereur Han règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de lui pour mener une guerre sans merci contre le Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par Liu Bei.
Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.
Furieux d'apprendre que les deux royaumes se sont alliés, Cao Cao envoie une force de 800 000 soldats et 2 000 bateaux pour les écraser.
L'armée campe dans la Forêt du Corbeau, de l'autre côté du fleuve Yangtze qui borde la Falaise Rouge (Chi Bi) où sont installés les alliés. Face à l'écrasante supériorité logistique de Cao Cao, le combat semble joué d'avance, mais Zhou Yu et Zhuge Liang ne sont pas décidés à se laisser faire...
Dans un déluge de puissance et de génie tactique, la bataille de la Falaise Rouge va rester comme la plus célèbre de l'Histoire et changer le destin de la Chine pour toujours.
Autant vous le dire tout de suite, difficile pour moi d'être objectif sur ma chronique de ce film tant il me tient à cœur.
Je m'autorise donc à y mettre un peu de ma personne pour éclaircir les raisons de mon engouement et parce que j'en ai envie, d'abord.
Buckle up, we're going back in time :)
Tout commence au lycée où je découvre, par le plus grand des hasards et l'intermédiaire d'un ami, un jeu sur Playstation 2 nommé "Dynasty Warriors 2".
A première vue, il ne s'agissait que d'un vulgaire beat them all asiatique où l'on incarnait des personnages plus ou moins anguleux dans des champs de bataille plus ou moins désertiques. C'était les débuts de la console...
Malgré son principe extrêmement basique et répétitif (taper, taper, taper très fort!), je lui reconnaissais un côté attachant.
Taper d'accord mais quand on parvient à renverser le cours d'une bataille par la seule force de son personnage, ça vous fait tout de suite bomber le torse.
Et quand en plus les personnages débordent littéralement de charisme, c'est un vrai plaisir que de partir au combat!
Bref, un coup de cœur inattendu.
Quelques temps plus tard, je réussis à mettre la main sur l'opus suivant, intelligemment nommé "Dynasty Warriors 3".
Et là c'est l'éclair qui vous traverse la tête, l'épiphanie, la révélation!
Parmi les oeuvres cultes, la plupart des gamers hardcore ne tarissent pas d'éloges sur les "Final Fantasy" et autres "Starcraft" et "Warcraft".
Moi je suis bel et bien tombé amoureux des "Dynasty Warriors".
Pourtant, il fallait vraiment s'accrocher pour entrer dans le jeu ; les généraux chinois doublés par des joueurs de pétanque de la Cannebière ne facilitant pas les choses...
Mais voilà, avec sa multitude de personnages, ses attaques variées, ses combos jouissifs, ses dizaines de niveaux gigantesques et ses nouveaux graphismes hauts en couleurs, le jeu m'avait décidément tapé dans l'oeil.
En plus, il avait un côté jeu de rôle fort sympathique.
Si au départ on commençait comme paysan avec une vulgaire épée en bois, très vite on pouvait monter en grande et gagner de nouvelles armes et compétences.
Aux enchaînements de folies s'ajoutait alors la possibilité de traverser de vastes étendues à bride abattue, de dégommer vicieusement un général ennemi d'une flèche bien placée, d'entraîner ses propres gardes du corps ou encore de s'approprier des tonnes d'objets spéciaux pour booster ses capacités.
C'était vraiment gratifiant d'être félicité pour ses prouesses guerrières et de combattre aux côtés des plus grands.
Sans oublier que selon ses actions et si l'on suivait ou non les ordres, le cours de la bataille pouvait changer du tout au tout et la musique faisait de même, mettant en valeur l'aspect héroïque des combats.
Le jeu offrait de vrais moments d'anthologie (première rencontre avec un éléphant à Nanman, le chateau de Fan recouvert par les eaux ou simplement Lu Bu...) et des champs de bataille dantesques sur lesquels il n'était pas rare de guerroyer férocement pendant plus d'une heure jusqu'à en avoir mal aux pouces.
Mais ce que je trouvais absolument génial, c'était la possibilité de pouvoir faire les campagnes sous l'ordre de chaque armée et non pas une seule imposée.
Ainsi, on découvrait l'histoire de chaque personnage et les alliés d'aujourd'hui devenaient les ennemis de demain.
Un choix passionnant pour une absence totale de manichéisme.
Après le 3, vint le 4 puis le 5 sans oublier les innombrables extensions sorties uniquement dans le but de faire cracher ses derniers centimes aux pauvres fans en manque de sensations. Car il faut bien l'avouer, les jeux se suivaient et se ressemblaient beaucoup. A peine quelques nouveautés faisaient leur apparition ici et là pour tenter, par exemple, de dissimuler la pauvreté abyssale de l'IA ennemie...mais passons.
Comme on dit au pays du Soleil Levant : "Quand on nem, on ne compte pas" (désolé...).
Sans me la jouer tragédie grecque, je dois avouer que ce jeu a bouleversé mon existence. Après avoir passé des journées entières à admirer les superbes mouvements de lance de plusieurs personnages, je me suis même mis au combat au bâton. C'est pour dire.
Cherchez pas, y a des gens comme ça...
Mais pourquoi je raconte tout ça, moi?
Tout simplement parce que les jeux vidéo "Dynasty Warriors" font partie des incalculables adaptations (avec les mangas, les séries télé et autres bandes dessinées) de ce monument de la littérature chinoise qu'est "Les 3 Royaumes".
En effet, "Les 3 Royaumes" est un roman historique chinois dont l'histoire se déroule vers la fin de la dynastie Han et la période qui se situe aux alentours de 220-265.
Ecrit par Luo Guanzhong au 13ème siècle, d'après l'œuvre de Chen Shou, c'est avant tout 7 volumes de 300, 400 pages chacun.
Malgré son ancienneté, le roman reste certainement le plus populaire en Chine et son influence s'étend par delà les frontières (la preuve : je l'ai lu!).
Les 3 Royaumes sont donc...3 et sont : le Wei, le Shu et le Wu ou pour simplifier, dans le jeu comme dans le film, les bleus, les verts et les rouges.
Pourquoi cette passion pour une histoire vieille de plusieurs siècles (en même temps allez dire ça à ceux qui considèrent la Bible comme livre de chevet...)?
Simplement parce que derrière un roman historique d'apparence austère, se cache en réalité une œuvre complexe, d'une grande beauté et d'une richesse inouïe.
Mêlant réalisme et surnaturel (les pouvoirs de Zhuge Liang...), il réussi à créer une véritable mythologie dont les personnages font partie intégrante.
Ainsi, chaque héros, de par son nom, ses actes et son apparence acquiert rapidement une portée universelle.
Très vite, des noms tels que Guan Yu, Cao Cao, Dian Wei, Wei Yan, Lu Bu, Zhang Liao, Liu Bei, Sun Shang Xian...se rattachent à des faits héroïques et des batailles célèbres qui ont changé le cours de l'Histoire de la Chine. C'est pas rien.
Tout ça pour dire que pendant plusieurs années, l'histoire des 3 Royaumes chinois était devenue une vraie passion, solide et sincère, à laquelle j'ai consacré un temps fou.
Il y a quelques mois dans un magazine ciné, je tombe sur un article annonçant officiellement que John Woo était en train de tourner un film sur une bataille mettant en scène les 3 Royaumes précédemment cités.
Je peux vous assurer que j'en ai poussé des cris à faire pâlir une groupie Twilighteuse!
John Woo! Un de mes réalisateurs préférés qui fait un film sur une des plus belles histoires que je connaisse! Même dans mes rêves les plus tordus, je n'aurais jamais imaginé que cela se produise un jour! A deux doigts de la camisole que j'étais.
Et c'est ainsi qu'après des mois d'attente. Je vais voir LE film qui résume toute une époque de ma jeunesse. Et le jour de mon anniversaire, en plus!
Il y en a qui appellent ça le hasard, d'autres une coïncidence... moi j'appelle ça le destin!
.....................................................................................
Ca y est vous pouvez revenir, j'ai fini ma séquence "diapos-souvenirs"....
Je vais enfin parler du film lui même.
John Woo. Dernier film en date : "Paycheck", en 2003.
Ca faisait un bail que le maestro n'avait rien tourné.
Après l'échec relatif (mais commercial) de "Windtalkers, Les messagers du vent" et le falot "Paycheck", on pressentait que Woo avait fait son temps.
Bridé par les studios hollywoodiens, il décide de faire "Volte/Face" et regagne enfin ses pénates sur sa terre natale.
Grand bien lui fasse : il va pouvoir prouver au monde qu'il n'a rien perdu de sa superbe et que le cinéma chinois peut tenir tête à n'importe quelle grosse machine Hollywoodienne!
Après 30 ans de gunfights acharnés, John Woo se refait une santé mode wu xa pian, genre qu'il n'avait pas abordé depuis "La dernière chevalerie" en 1979.
Les armes à feu sont ainsi remplacées par des lames de toute sorte, ce qui n'enlève en rien au côté spectaculaire du film pour autant.
Après la sortie de la trilogie du "Seigneur des Anneaux" de Peter Jackson j'étais persuadé que le cinéma en était à son point culminant, que les scènes de bataille ne seraient jamais dépassées, que tout ce qui viendrait par la suite serait forcément de qualité inférieure.
6 ans se sont écoulés depuis "Le Retour du Roi" et plusieurs fois déjà on m'a prouvé que j'avais tort.
"Les 3 Royaumes" réitère la démonstration avec bonheur.
Cinéaste de la violence lyrique, Woo dispose pour son film d'une logistique "A toute épreuve" et de moyens techniques à faire baver les frères Scott (mais non pas la série, les réalisateurs!).
Doté d'un budget colossal de 80 millions d'euros, il s'autorise tous les excès pour donner vie à l'une des plus importantes batailles du monde chinois.
Non seulement il engage un millier de figurants(!) mais il fait construire sur place la majorité des éléments nécessaires à la reconstitution de ladite bataille.
S'il se sert habilement des images de synthèse, ce que l'on voit à l'écran est tout sauf une armada de polygones pixellisés...
La folie des grandeurs?
Le plus gros risque du film aurait été de faire un copier-coller de tout ce qui a déjà été fait des dizaines de fois. Par chance, grâce aux stratégies renversantes mises en place par les différents généraux, les scènes de bataille se suivent mais ne se ressemblent pas.
Pluies de flèches, charges de cavalerie, bombardement à coups de catapultes... le film ne recule devant rien pour nous en mettre plein la vue et parvient à se renouveler constamment.
Filmées dans des décors majestueux, ces scènes surprennent par leur démesure.
Le genre qui vous laisse essoufflé, un stupide sourire béat aux lèvres.
En un film, John Woo va jusqu'à recréer Pearl Harbour et le Débarquement.
Sans oublier que les guerriers en sous-nombre mais dotés d'une force surhumaine font irrémédiablement penser à un "300" à la sauce chinoise.
Du grand spectacle, donc.
Si la mise en scène, recherchée et stylée, de John Woo compose des images inoubliables comme lui seul sait les faire, on remarque qu'il emploie moins les ralentis (véritable marque de fabrique du cinéaste) qu'auparavant.
Ce qui ne l'empêche pas de nous offrir des plans éblouissants comme la récupération des flèches et d'apporter un véritable souffle épique, comme avec la technique des 8 trigrammes.
Et surtout, il se fait plaisir avant tout, notamment avec cette colombe, sa signature(!), qui survole la flotte ennemie en un plan séquence virtuose.
De même, la musique du film est en tout point remarquable.
Généralement assourdissante lors des grandes manœuvres, elle sait se faire douce lors de scènes plus intimistes ou encore malicieuse pour souligner le côté mutin des ruses de Zhuge Liang (voir une fois de plus la scène "comment récupérer 100 000 flèches gratos?"). Elle souligne avec panache l'ampleur des escarmouches et met en valeur l'héroïsme exacerbé des combattants.
L'héroïsme est d'ailleurs l'un des thèmes de prédilection du réalisateur.
On lui attribue souvent les titres de "cinéaste de la violence" mais c'est oublier à quel point John Woo aime ses personnages. S'il magnifie à tel point la violence dans ses films, c'est paradoxalement pour la dénoncer.
Ceux qui connaissent ses œuvres savent parfaitement que John Woo est un grand romantique.
Ce qu'il aime c'est avant tout raconter de belles histoires. D'amour et d'amitié.
Amour. L'amour entre les êtres, voilà la philosophie de celui que l'on dénonce comme étant responsable de l'ultra-violence au cinéma.
Qui peut oser dire que les histoires d'amour dans ses films ne sont pas parmi les plus belles et les plus tragiques jamais mises en scène ("The Killer", à chaque fois j'ai la larme à l'oeil, damn' it!)? Comment ne pas être subjugué, dans "Les 3 Royaumes", lorsque l'espiègle Sun Shang Xian s'effeuille en laissant apparaître un croquis du camp adverse? Comment ne pas être hypnotisé par la beauté de la courtisane de Cao Cao (Zhen Jiiiiiiiiiii!!!!!)?
Comment ne pas esquisser un frisson lorsque Xiao Quiao se jette délibérément dans la gueule du loup pour tenter de sauver son peuple?
John Woo aime les femmes et ça se voit!
Amitié. Les amitiés viriles, la loyauté, le sens de l'honneur et du sacrifice.
Un refrain que l'on retrouve dans tous ses films.
Les liens affectifs sont très forts chez les personnages, qui n'hésitent pas à donner leur vie pour "A Better Tomorrow".
D'ailleurs les personnages sont, comme dans le roman éponyme et le jeu vidéo, ultra-charismatiques!
Ceux qui ne sont pas familiers avec les protagonistes risquent de décrocher face aux nombreuses têtes et noms qu'il faudra retenir pour comprendre les enjeux de la bataille. Pour les passionnés comme moi, c'est un bonheur indescriptible que de voir ses héros favoris prendre vie à l'écran.
Soyons honnêtes, certains prennent plus de place que d'autres mais quelle euphorie d'assister à leurs exploits grandioses (Zhao Yun qui sauve le fils de Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei qui combattent côte à côte, Huang Gai qui prépare l'attaque par le feu...). C'est juste magique.
On reconnait que même si John Woo a cherché à respecter le plus possible les faits historiques, il se laisse parfois aller à quelques digressions.
En revanche, il a le mérite d'avoir réussi à croquer (du verbe "faire un croquis") les personnages sans perdre de temps et de manière marquante. Chacun bénéficie d'une petite scène d'introduction qui met en valeur ses principales qualités.
Ainsi un grand guerrier martial comme Guan Yu surgit d'une rangée de boucliers avant d'anéantir à lui seul toute une escouade et de se pavaner avec l'étendard ennemi, un amateur de musique comme Zhou Yu est montré une flûte à la main, tandis que Zhang Fei, tout en force brute et barbe hirsute, va jusqu'à envoyer valser un cheval d'un coup d'épaule.
Au passage, les demeurés mous du bulbe ne manqueront de faire remarquer à leur entourage la ressemblance de Zhang Fei avec un certain Chabal...
A ceux là je lève mon majeur bien haut et je citerai un Gabin bien plus éloquent que moi :
"Qu'est-ce que vous êtes venus faire sur Terre, vous n'avez pas honte d'exister ? Affreux, je vous chasse de ma mémoire, je vous balaie."
Les scènes d'action sont d'ailleurs bien représentatives du mythe que John Woo cherche à faire perdurer.
Rien d'étonnant donc à ce que ces soldats d'élite à la force surhumaine soient capables de décimer une demi douzaine de soldats ennemis d'un seul coup de lance bien placé.
En parlant des personnages, un petit mot rapide sur le casting.
Si Chow Yun Fat brille hélas par son absence (mais il aurait joué qui?), on retrouve le formidable Tony Leung, qui en est à sa troisième collaboration avec John Woo, et Takeshi Kaneshiro que l'on a pu voir récemment dans "Les Seigneurs de la Guerre".
Si la présence de ce dernier ne fait pas l'unanimité parmi les puristes, pour ma part je le trouve très appréciable dans la peau d'un Zhuge Liang astucieux mais réservé.
Les acteurs restants me sont plus ou moins familiers mais ils s'acquittent tous, jusqu'au troufion de base, de leur rôle respectif avec talent et conviction.
Un sans faute.
Mais le film n'est pas qu'une succession incessante d'affrontements musclés et sanglants. John Woo prend également son temps pour installer des séquences plus contemplatives. Le calme avant la tempête.
Loin de n' être qu'un exutoire entre deux boucheries, ces scènes ont une importance capitale dans le déroulement de l'histoire.
La guerre se joue sur plusieurs niveaux et pas que sur le champ de bataille.
Un duel de cithare, un vol de colombe ou encore la cérémonie du thé, ces minutes de répit ne sont jamais innocents et cachent un dessein plus grand que ce que l'on croit aux premiers abords.
Une tortue, un rayon de soleil ou bien une simple flammèche suffisent à ce "Messager du vent" qu'est Zhuge Liang pour concocter une série de tactiques admirables...
Ces scènes sont aussi l'occasion d'en découvrir plus sur la personnalité et les motivations de chacun. En revanche, il est vrai que cette partie est parfois sous exploitée.
Mais n'oublions pas que le film a été emputé de moitié(!) pour parfaire aux exigences du public occidental, peu habitué aux fresques en chinois sous-titré d'une durée minimale de 4h...
Il est donc plausible que les personnages soient plus approfondis dans la version longue.
Qui satis expectat, prospera cuncta videt.
Par chance, le film n'a pas été massacré par des monteurs américains pour le marché mais bel et bien remanié par John Woo lui même, à l'aide de son monteur attitré et ami de longue date, David Wu.
David Wu, dont le talent n'est plus prouver (nominé une bonne dizaine de fois aux Hong Kong Awards), confère au film une tension fascinante et un rythme effréné. Passé un prologue un peu longuet, les deux heures trente passent à une vitesse folle.
Pour une fois que "version courte" n'est pas péjoratif, on ne va pas s'en plaindre!
Ceux qui ont foncé directement au bas de l'article pour découvrir la note en premier lieu seront sûrement étonnés de voir, qu'après tant d'éloges, je ne mette pas **** au film.
C'est simple, et là ce n'est plus le fan hystérique qui parle mais l'amateur de cinéma : "Les 3 Royaumes" est excellent en tout point mais ne renouvelle pas le genre.
Visuellement éblouissant et logistiquement ahurissant, il ne reste pas moins qu'il manque parfois de souffle épique et ne se distingue de la masse (dont le récent et tout aussi remarquable "Les Seigneurs de la Guerre") que par son budget phénoménal dont John Woo peut se permettre d'employer à bon escient.
Mais même sous la torture, jamais il ne me viendrait à l'idée de me plaindre du film. "Les 3 Royaumes" c’est un rêve de gosse, rien de moins !
Quand on voit ce que les ricains nous préparent avec "Dragon Ball" (y en a qui mériteraient "Une balle dans la tête"!), je ne peux que verser des larmes de joie quand "Les 3 Royaumes" est adapté à l'écran par un Chinois pure souche! Et pas n'importe lequel surtout!
On a échappé au pire et on se retrouve avec le meilleur, que demander de plus?
Héros charismatiques, réalisation époustouflante et mise en scène dantesque, John Woo fait son retour au pays en grandes pompes et se lance corps et âme dans cette adaptation flamboyante d'une épopée légendaire.
Après une série d'échecs relatifs, commerciaux ou artistiques, du côté de chez nous, il retrouve sa verve incomparable et nous prouve, à grands renforts d'images grandioses, qu'il reste bel et bien "The Killer" dans sa catégorie.
Sur ce je vous laisse, je vais me refaire une petite partie de "Dynasty Warriors"...
Note : ***
Note : **** pour les fans de "Dynasty Warriors" :)