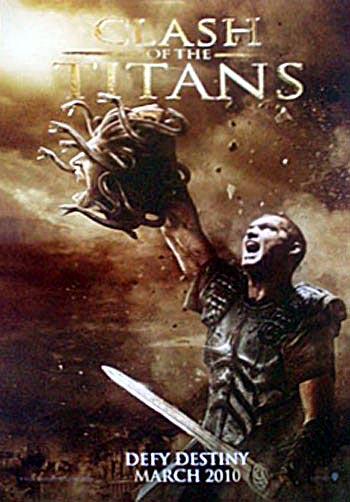Depuis déjà longtemps, Aileen erre sans but et se prostitue pour survivre. Lorsqu'un soir elle rencontre dans un bar la jeune Selby, c'est le coup de foudre. Pour protéger leur amour et leur permettre de subsister, Aileen continue de se vendre jusqu'à cette nuit où elle est agressée par un de ses clients et l'abat...
Les jolies filles et les oscars ont rarement fait bon ménage. Il semblerait même que pour recevoir la fameuse statuette, plus on est moche, plus on a de chances...Et cela ne date pas d'hier. Bette Davis nominée pour son rôle dans « What happened to Baby Jane? », ou Kathy Bates dans « Misery » pour ne citer qu'elles. Plus recemment Marion Cotillard fait sensation grimée à la Edith Piaf et la top model Charlize Theron enflamme la foule avec « Monster ».
Il faut bien l'avouer si l'actrice n'avait pas reçu les honneurs de la presse pour son interprétation, le film serait certainement passé inaperçu dans les salles. Ce film, glauque et violent, est en effet loin d'être commercial et aurait difficilement pu attirer autre qu'un public élitiste.
« Monster » raconte l'histoire vraie de Aileen Wuornos, prostituée depuis son plus jeune âge, qui devient la première tueuse en série d'Amérique. Cette femme meurtrie et ravagée tant physiquement que moralement, Charlize Theron l'interprète à la perfection. Largement aidée par un maquillage haut de gamme (masque en latex, lentilles, faux dentier...), sa transformation est saisissante. L'actrice réputée pour sa beauté n'a pas hésité à s'avilir physiquement pour coller le plus possible à son personnage. Finie les robes élégantes et les coiffures exotiques. Place aux haillons informes et aux cheveux gras et hirsutes. Adieu la taille de guêpe qui fait la couverture des magazines, bonjour aux 15 kilos en trop et à la peau d'orange qui font fuir.
Mais un personnage de cinéma, ce n'est pas seulement une apparence qui masque une enveloppe vide. Si la métamorphose de l'actrice est en tout point remarquable, c'est bel et bien son jeu qui laisse pantois. Pour composer le personnage d'Aileen, Theron s'est plongée dans d'innombrables recherches et a fréquenté de nombreuses personnes qui connaissaient la vraie Aileen, ce qui lui a permis de capter la véritable essence de cette femme hors du commun. On sent que l'actrice a été bouleversée par son histoire et elle nous fait ressentir ce traumatisme à travers des expressions criantes de vérité. Tout comme la fameuse scène du miroir brisé l'explicite, elle souligne à merveille la dualité de son personnage. En une scène, elle nous enchante avec un de ses sourires ravageurs dont elle a le secret avant d'hypnotiser la caméra par un regard sanguinaire à faire reculer une meute de loups. Lorsque on voit l'actrice à l'écran, ce n'est plus elle mais bien le personnage qu'elle incarne.
Oscar, Golden Globe ou n'importe quelle autre récompense reçue sont largement mérités!
Mais il serait injuste de résumer tout le film par la seule présence de l'actrice.
Tout d'abord, il n'y a pas une actrice mais deux. La deuxième c'est Christina Ricci qui est comme toujours magnifique et dont le jeu en retrait contraste admirablement avec celui terriblement physique de Charlize Theron. Les personnages d' Aileen et Selby n'ont rien en commun mais se complètent à merveille comme le font les deux comédiennes à l'écran: chaque scène où elles sont ensemble nous fait profiter du formidable talent des deux actrices, qui par ailleurs ne reculent devant rien pour donner corps à leur interprétation...
Mais « Monster » c'est aussi l'histoire poignante d'une personne qui sombre dans le mal en tentant de faire le bien. Le quotidient d'Aileen n'est que misère et indifférence. Selby devient alors sa lumière dans les ténèbres et quand elle la trouve elle ne cherche qu'à s'enfuir avec pour la garder précieusement. Plus que le récit sordide d'une tueuse en série, c'est avant tout une histoire d'amour impossible qui mène à la tragédie.
La réalisatrice Patty Jenkins a été profondément troublée par l'histoire de la vraie Aileen et ne cherche qu'à dévoiler la vérité sur sa vie. En aucun cas, elle ne se laisse aller à l'auto-censure, aux passages édulcorés et à la happy end hollywoodienne de rigueur. Non. Ici le manichéisme n'est pas de mise, les relations entre les personnages sont aussi complexes qu'ambigües et l'impression de vérité qui se dégage de leur relations n'en est que plus forte.
Cette impression de vérité est à la fois la force et la faiblesse du film. La force parce que les personnages sont incroyablement crédibles et que l'on entre tout de suite dans le film, la faiblesse parce que comme la réalisatrice se contente de raconter les faits sans donner de jugement, la mise en scène reste souvent très froide et quelques longueurs peuvent finir par rebuter.
« Monster » mérite avant tout d'être vu pour l'interprétation sensationnelle de Charlize Theron, pour le couple qu'elle forme avec Christina Ricci et pour le portrait sans détour qui est fait de cette prostituée aux abois. En revanche, son côté poisseux, sa noirceur très prononcée et quelques passages moins réussis que d'autres ne feront certainement pas l'unanimité.
Note : **