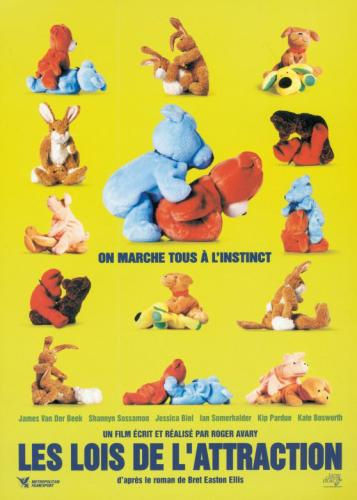Jeunes et insouciants, cinq amis traversent le Texas à bord d'un minibus. Ils s'aperçoivent bien vite qu'ils sont entrés dans un territoire étrange et malsain, à l'image du personnage qu'ils ont pris en stop, un être vicieux en proie à des obsessions morbides...
On dit que le film est si terrifiant qu'on n'oublie jamais la première fois qu'on voit « Massacre à la Tronçonneuse »...
Néanmoins, la réputation sulfureuse du film vient plus de son interdiction dans de nombreux pays pour sa violence extrême que pour ses réelles qualités cinématographiques.
En le voyant, on comprend aisément qu'il n'a pas usurpé son titre de "film le plus terrifiant de tous les temps" mais fait-il encore le poids face aux standards d'aujourd'hui?
En 74 (date de sortie du film), le film a du être un électrochoc pour de nombreux spectateurs.
Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait jamais rien vu de semblable.
On peut considérer les années 70 comme un renouveau dans le cinéma d'horreur.
Deux ans avant « Massacre à la Tronçonneuse », Wes Craven vient de finir « La dernière maison sur la gauche » dont on dit que « Massacre à la Tronçonneuse » s'est beaucoup inspiré.
De même que le film de Wes Craven, on a longtemps considéré « Massacre à la Tronçonneuse » comme un pamphlet contre la famille américaine de l'époque et sa perversité latente (le masque, symbole des désirs refoulés que l'on cache derrière une autre apparence ?).
En tout cas, il est vrai qu'entre les deux films les ressemblances sont parfois flagrantes : même grain à l'image, même famille de psychopathes, mêmes meurtres sanglants mais filmés de manière réaliste, même ambiance malsaine et même escalade dans la violence sans concession.
En parlant de violence, « Massacre à la Tronçonneuse » soulève un point interessant : Jusqu'où peut-on aller sur un écran?
Du point de vue philosophique, comme « Chiens de Paille » de Peckinpah (Franklin qui joue constamment avec son couteau mais qui n'arrive pas à comprendre comment on peut s'entailler la main avec fait écho à la scène où Dustin Hoffman part chasser), mais surtout du point de vue visuel.
« Massacre à la Tronçonneuse » est pour beaucoup synonyme de « hectolitres de sang » alors que dans les faits, le sang brille justement par son absence.
Il y en a bien un peu par ci par là mais les gens sont dans le tort lorsqu'ils imaginent le film.
« Imaginent » parce que, de par sa réputation d'abord, le titre ne donne pas forcément envie de le voir alors la majorité se « fait le film » sans même l'avoir vu, ensuite parce que la plupart de ceux qui ont réellement vu le film ont cru(!) voir tout ce sang.
Pourquoi? Tout simplement grace à la mise en scène incroyablement suggestive de Tobe Hooper qui en montre peu mais nous fait croire beaucoup. Grace à son sens fulgurant du montage, il nous plonge en plein coeur de l'horreur tout en évitant de nous montrer le moindre membre tranché.
D'une pierre deux coups : il fait s'affoler notre imagination, qui réinvente les scènes, et évite de se ridiculiser en employant des effets spéciaux bas de gamme (dus à un budget serré) qui auraient donné dans le grand gignol.
Parce que la vraie force du film c'est que non seulement il ne sombre pas dans la surenchère de tripailles et de gore à tout va mais, en évitant le second degré inhérent à ce genre de production, il n'offre que de très rares moments de détente, nous tenant constamment sous pression.
Avant tout, un prologue nous informe que le film est basée sur des faits réels...canular du réalisateur qui lui permet de placer le spectateur dans un contexte horrifique dès le départ. Pour accentuer le côté véridique de la chose, les premières images du film sont des photographies dont le flash aveuglant laisse à peine entrevoir des os broyés et des morceaux de chair pourrissants.
Le procédé est absolument brillant et sera repris plus tard dans des dizaines de bandes annonces (dont celles du remake, de Marcus Nispel...)
Visuellement, Tobe Hooper, encore jeune étudiant, profite au maximum de son budget rachitique pour créer une atmosphère qui dégoûte et qui écoeure.
Le grain de l'image d'abord, la lumière étouffante ensuite, créent une ambiance particulièrement malsaine.
La bande son elle même n'offre aucun réconfort : entre deux ronrons de tronçonneuse, grésillements et bruits de perceuse se succèdent pour le plus grand malheur de nos tympans...
Mais le réalisateur sait aussi jouer des silences pour nous tenir en haleine : le plan de la porte ouverte est un monument d'appréhension..
Rarement ambiance sonore aura été aussi prenante!
Et si on associe avant tout le film à Leatherface, les personnages secondaires sont réellements effroyables.
La scène de l'auto-stoppeur est à la fois flippante (l'acteur est parfait!) et écoeurante. Quant à celle du dîner elle reste l'une des plus mémorables du film.
Filmée de façon quasi documentaire, elle nous place en qualité de voyeur et nous oblige à regarder le meurtre de cette jeune fille sans défense (l'actrice a du avoir une extinction de voix pendant plusieurs jours en criant autant, la pauvre...).
Un réalisme saisissant!
Le film pousse le bouchon particulièrement loin dans le sadisme et la perversité.
Un personnage est suspendu à un crocher de boucher, l'autre se fait découper bien proprement avant d'être servi à dîner...
L'héroine s'en prend vraiment plein la tête : coups de balai, coups sur la tête, défenestrations, sauts, course à travers les bois...rien ne lui sera épargné.
Mais là où « Massacre à la Tronçonneuse » surprend réellement, c'est par son abscence de morale bien pensante. En général, les films d'horreur se focalisent sur des ados en proie à la promiscuité comme victimes potentielles. Ici tout le monde se retrouve logé à la même enseigne, même les handicapés...
Mais surtout « Massacre à la Tronçonneuse » ne met pas en scène de méchants escargots qui font du surplace quand il s'agit de découper les gens en rondelle.
On s'imagine facilement Leatherface en émule balourd de Frankenstein, s'avançant lentement vers l'héroine en fendant l'air de mouvements ridicules avec son engin de mort juste pour montrer que c'est lui le plus fort (et aussi pour que l'héroine en question puisse trouver un échappatoire miracle au dernier moment...).
C'est donc autant plus impressionnant de le voir courir (et il est rapide le bougre!) quand il poursuit la fille dans les bois. C'est vrai qu'il s'arrête souvent pour élaguer les branches mais la scène reste terriblement efficace : on y croit!
Malgré tout la fin reste trop classique (deus ex machina...) et la « danse » de Leatherface fait autant sourire qu'elle répugne. Le voir exécuter cette série de mouvements « artistiques » sur fond de coucher de soleil a vraiment quelque chose de fascinant.
Avec du recul, certaines scènes prêtent à sourire : la plupart des « gentils » sont transparents et Hooper abuse parfois des gros plans extrêmes.
La fin est décevante pour certains et le film, dans l'ensemble, suit un rythme plutôt lent. Bien que court (1h23), on s'ennuie un peu.
Mais ça c'est parce que le film a déjà plus de 30 ans et qu'en tant que spectateurs « modernes » on est plus habitués à des mises en scène rapides et des effets gore à gogo.
Malgré ses qualités, le film aura du mal à convaincre les adeptes des « Saw » et autres « Hostel » qui fleurissent sur les écrans comme des petits pains (euh, ça fait bizarre comme expression...) : je le répète, il n'y a quasiment pas de gore dans le film.
Mais « Massacre à la Tronçonneuse » c'est avant tout un symbole.
Le symbole de toute une génération traumatisée par des scènes jamais vues auparavant, mais aussi une pierre blanche dans l'histoire du film d'horreur.
On ne peut nier l'influence qu'à eu le film sur la grande série de slashers qui sévira durant les années 80/90.
Le masque de Leatherface est à lui seul une icône du cinéma et a engendré un grand nombre de rejetons dont celui de « Scream », « Halloween », « Jason » et j'en passe.
D'ailleurs, tout comme Leatherface (qui ne pousse que quelques cris), Mike Meyers et Jason sont des tueurs muets. Et c'est leur abscence d'expression qui les rend si terrifiants,... si inhumains.
C'est bien le masque du tueur qui lui donne sa personnalité.
Détail amusant pour finir: Leatherface a un masque différent selon qui il interprète : le voir habillé en grand-mère n'est pas banal...
Le chef d'oeuvre ultime de Tobe Hooper reste un monument du film d'horreur.
Malgré quelques passages marqués par le temps, le film réserve de sacrés moments de frayeur.
Son ambiance suffocante et la performance immortalisée de Gunnar Hansen en Leatherface suffisent pour faire de « Massacre à la tronçonneuse » une expérience traumatisante. S'il laissera peut être de marbre le public d'aujourd'hui, il bat à plate couture la plupart des films récents du genre, le sur-estimé « Eden Lake » en tête.
Reste à voir ce que vaut le remake...
note : ***