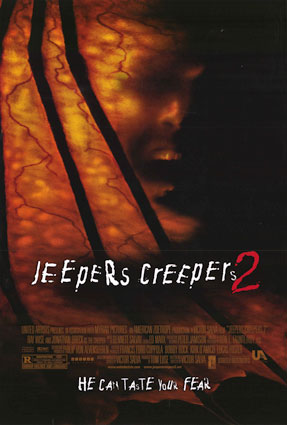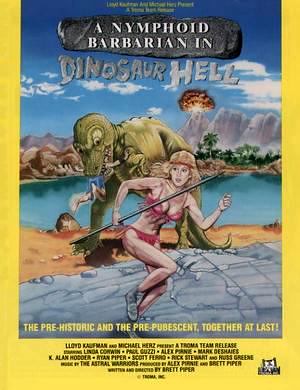Une petite princesse poisson rouge appelée Ponyo veut désespérément devenir humaine. Dans sa quête, elle devient amie d'un garçon de cinq ans, Sosuke.
Si chaque film de Hayao Miyazaki est un événement, celui là l'est d'autant plus car après avoir annoncé, à la grande deception de nombreux fans, qu'il arrêtait définitivement le cinéma, le maître revient sur sa parole, et sur les écrans par la même occasion.
Et c'est vrai qu'il nous manquait tout de même.
Après un coup d'essai, dans l'eau, du fiston (Goro Miyazaki ; « Les contes de Terremer ») pour reprendre le flambeau, on ressentait un vrai manque chez le studio Ghibli.
Mais que cela ne tienne, l'un des plus grands génies de l'animation est enfin de retour!
Pourtant, il fallait bien un projet de grande envergure pour que Miyazaki décide de refaire surface.
Surnommé à tort, le Walt Disney japonais, il risque bien de s'attirer les foudres des Disneyiens fanatiques qui verront en « Ponyo sur la Falaise », une adaptation éhontée de « la Petite Sirène » : une histoire d'amour entre un jeune garçon et une fille de l'eau qui rêve de devenir humaine.
Néanmoins, la comparaison s'arrête là. Si Miyazaki s'inspire effectivement de « La Petite Sirène », c'est moins du dessin animé que du conte originel d'Andersen, qu'il transpose dans le Japon d'aujourd'hui.
Fasciné par la mer, Miyazaki en profite pour donner vie à l'une des faunes aquatiques les plus éblouissantes jamais vues dans un film d'animation. Bien loin de l'anthropomorphisme du « Monde de Némo », auquel on peut le rapprocher, le monde marin de Ponyo est constitué avant tout de créatures réelles et réalistes.
Mais à celles là s'ajoutent des êtres originaux et insolites, véritables représentants du folklore japonais, dont des vagues de poisson (au sens propre !), une déesse marine à la beauté irréelle, et bien entendu la Ponyo du titre.
En parlant de Ponyo, a t-on déjà vu une bestiole aussi craquante? Croisement improbable entre un poisson rouge et un Totoro des mers, Ponyo est absolument adorable !
Miyazaki le sait et n'hésite pas à en rajouter dans le kawaï à grands coups de mimiques angéliques et d'énormes sourires malicieux...
D'ailleurs quand on voit l'apparence de Ponyo, on est certain d'une chose : le film est destiné en priorité aux enfants.
Ainsi, dans son ambiance, « Ponyo sur la Falaise » se veut plus proche de « Mon voisin Totoro » que de « Princesse Mononoke » ou « Porco Rosso ».
Pour autant, les connaisseurs savent que chez Miyazaki, « enfant » n'est jamais synonyme d' « idiot »,et en ce sens le film s'adresse tout aussi bien aux adultes.
Les enfants seront émerveillés par l'univers enchanteur de Ponyo, apprécieront l'humour et la qualité du dessin et se prendront d'affection pour des personnages terriblement attachants.
Quant aux plus grands...eh bien, ce sera la même chose.
En réalité le film ne touchera peut être pas tout le monde de la même façon car il ne s'adresse pas réellement à nous, adultes, mais bien à l'enfant qui sommeille en nous et qui refuse de grandir.
Le classicisme du scénario peut surprendre d'autant que la plupart des scènes ne font que montrer les différentes attitudes de Ponyo face au monde des hommes. Et les choses les plus simples sont souvent les meilleures : elle découvre le plaisir de boire du lait chaud, de préparer des nouilles, d'allumer une bougie ou simplement de courir à droite à gauche.
Des actes qui nous paraissent évidents mais qui ont une grande importance pour quelqu'un qui vient de les apprendre.
Miyazaki fait ainsi le rapprochement entre Ponyo qui découvre l'utilisation de ses jambes et ces vieilles dames qui aimeraient retrouver l'usage des leurs.
De même, lorsque leur village disparaît sous les flots, la population ne cède pas à l'angoisse et aux lamentations mais s'organise pour s'aider mutuellement.
Ainsi, c'est avec un étonnement certain qu'on les voit débarquer, tout guillerets, dans un défilé de bateaux dignes d'une fête nationale...
Dans d'autres mains, le film serait naïf voire grotesque et pourrait même frôler le mauvais goût (on ne rigole pas avec les inondations en ce moment...). Mais pas avec Miyazaki : ces séquences de découverte possèdent autant d'importance pour les personages du film que pour les spectateurs, qui sont alors invités à regarder le monde avec un regard nouveau, un regard d'enfant...
Ainsi, il est nécessaire de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit pour apprécier le film à sa juste valeur et de ne pas se montrer trop exigent.
Mais après tout, comment rester insensible face au trait sans faille de Miyazaki, qui sait donner à ses personnages à la fois du charme et un côté loufoque complètement tordant (bouches démesurées, yeux globuleux, démarche aléatoire...) et à ces couleurs éclantantes qui rappellent les estampes japonaises ?
Bien qu' absent des écrans depuis un bon moment déjà, Miyazaki nous prouve qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Sa mise en scène est un ravissement de tous les instants. Aux couleurs épurées de la surface, il oppose un feu d'artifice visuel pour représenter son monde marin.
Que ce soit lors des scènes sous marines, des moments entre Ponyo et Sosuke, ou Ponyo et sa mère ou encore des rares scènes d'action, Miyazaki parvient à saisir l'équilibre parfait entre poésie, fantastique et intimité.
Quoi qu'il en soit, on n'est pas dépaysé par rapport au reste de sa filmographie. « Ponyo sur la Falaise » comporte en effet les principaux thèmes, chers au réalisateur : le regard sur l'écologie (la mer jonchée de détritus), l'histoire d'amour entre un humain et un être appartenant à un autre monde, l'équilibre entre les humains et les forces de la nature (les vagues rappellent la fin de « Princesse Mononoke »)...
Quant à ses personnages, ce sont les mêmes archétypes qu'il réutilise à sa guise : les retraités symbolisent la sagesse, Ponyo et Sosuke peuvent se comparer au couple du « Château dans le ciel », la mère de Sosuke est une femme forte et indépendante (comme dans tous ses films), enfin le père de Ponyo et ses cernes grosses comme des valises sortent tout droit du « Château Ambulant »...
Mais que serait un film de Miyazaki sans la participation de Joe Hisaishi ? Compositeur attitré de Miyazaki, Hisaishi est à ses films ce que Morricone est à ceux de Leone : une évidence !
L'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. Avec eux, on ne sait jamais si c'est la musique qui s'adapte aux images ou bien le contraire tant la symbiose entre elles touche au divin. Une fois encore Hisaishi nous livre une partition exemplaire qui magnifie le dessin grandiose de Miyazaki.
Le prologue, tout en musique, est d'ailleurs réminiscent des meilleurs moments du « Fantasia », le fameux opéra animé de Disney.
Un grand moment de cinéma, une vraie cure de jouvence, 1h30 de romantisme fantastique et de poésie émouvante jusqu'à ce que la fin, abrupte, tombe et nous rappelle que non seulement le scénario était classique mais qu'en réalité il ne s'est pas passé grand chose comparé à l'envergure de l'histoire elle même (il paraît qu'on a frôlé la fin du monde. Pourquoi? Comment?) mais qu'en plus de nombreux éléments demeurent dans l'ombre, à jamais inexpliqués...
« Ponyo sur la Falaise » est le grand retour tant attendu de Hayao Miyazaki au cinéma. Une histoire passionante et universelle, des images et une mise en scène admirables et paradoxalement assez sobres, une musique magnifique, des personnages attachants et surtout la bouille impayable de Ponyo font de ce film un dessin animé superbe qui s'adresse, quoi qu'on en dise, à tous les âges et compensent aisément un scénario un peu trop proche du gruyère.
Si Miyazaki reste l'un des plus grands metteurs en scène de l'animation japonaise, elle est déjà loin l'époque des Totoros...
Note : ***